S’abonner à la lettre d’information
L'apport des tiers intervenants
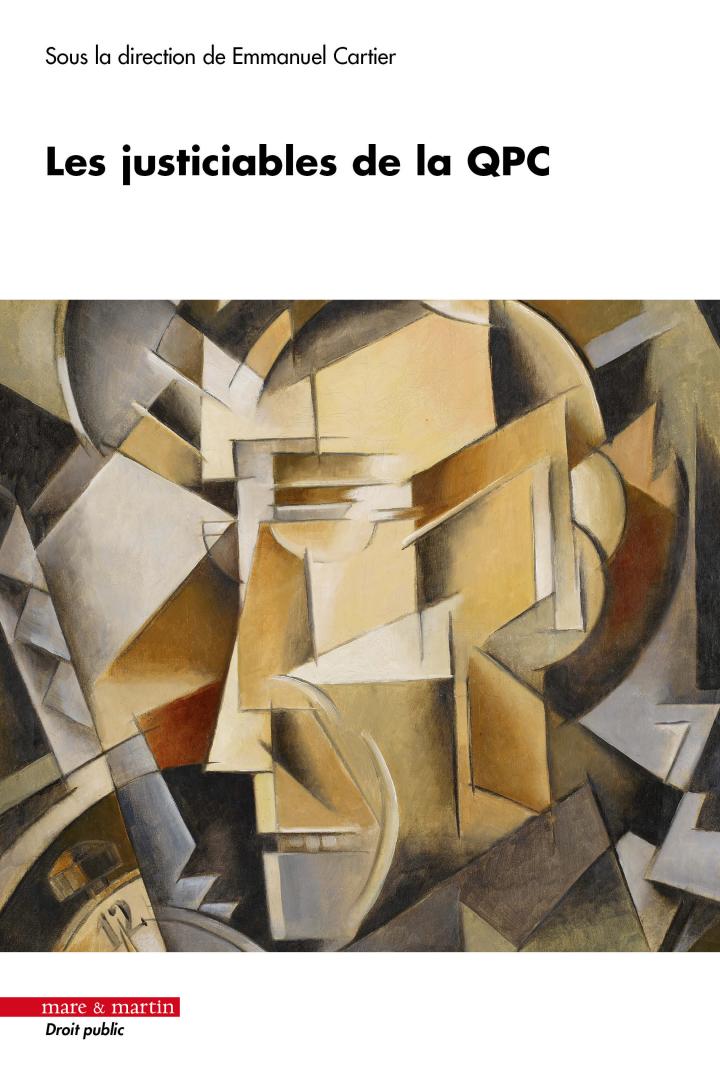
Cet article vient de paraître dans Les justiciables de la QPC, un ouvrage dirigé par Emmanuel Cartier, paru chez Mare & Martin.
Il s’agit du rapport scientifique d’une recherche réalisée à l’occasion des dix ans de la QPC.
Si le XIXe siècle fut le siècle des Parlements et le XXe celui de la justice constitutionnelle, alors gageons que le XXIe sera celui du citoyen, de l’individu. L’évolution constitutionnelle et démocratique qu’est l’introduction dans le contentieux constitutionnel français de la question prioritaire de constitutionnalité le confirme : après l’essor du Parlement au XIXe siècle, qui rendit nécessaire la limitation de son pouvoir par l’affirmation d’une justice constitutionnelle tout au long du XXe siècle, cette dernière devait enfin devenir accessible au justiciable. Le Conseil constitutionnel dut alors s’adapter : initialement conçu comme un « Conseil », au service de l’Exécutif contre le Parlement, il s’est affirmé comme un juge constitutionnel. Les évolutions qu’il connut en 1971 et en 1974 furent fondamentales et renforcèrent la garantie des droits et libertés, donc la démocratie elle-même. Mais encore dépourvu de tout accès au prétoire, le justiciable n’en profitait qu’indirectement et demeurait subordonné au bon vouloir des responsables politiques, qui décidaient librement de saisir le Conseil ou non.
Pour la même raison, le Conseil demeurait lui-même une instance fermée, seulement accessible à quelques privilégiés, à l’exception du contentieux électoral. En 2008, il s’ouvrit et se transforma de facto en juridiction, faute d’en avoir le titre de jure, même si tentative avait été faite de le qualifier de « Cour constitutionnelle » lors de la révision constitutionnelle, la consécration intervenant néanmoins de façon indirecte et tardive. Il dut ainsi intégrer toutes les exigences afférentes à une telle évolution, même si plusieurs d’entre elles avaient été anticipées (publication des saisines, publications des observations du Gouvernement, transmission de ces dernières aux requérants et possibilité pour eux de répliquer) et, en particulier, celles relatives au droit au procès équitable et au respect du principe du contradictoire.
Le « Règlement intérieur sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité » du 4 février 2010 tâcha alors de tout prévoir. Ou presque... car il manquait une réglementation des demandes en intervention. Ce silence initial résultait de la volonté de préserver le Conseil, en évitant de les inciter, et du parallélisme vis- à-vis de la procédure a priori, où les interventions existent, mais de façon officieuse. Appelées «portes étroites», selon le mot du Doyen Vedel, elles n’ont aucune valeur officielle, elles ne sont pas mentionnées dans les décisions et sont laissées à la disposition du rapporteur, qui peut décider de s’en servir ou non, de les évoquer en séance ou non, de les suivre ou non, de les jeter ou non, de les encadrer ou non...
Ces portes étroites avaient essentiellement pour objectif d’encourager le Conseil à soulever « d’office » un grief qui n’était pas mentionné par les requérants « officiels ». Lors de l’adoption du règlement de procédure du 4 février 2010, elles furent donc intégrées à demi- mot, puisque l’article 7 réserve la possibilité, pour le Conseil, de soulever des griefs d’office, en imposant alors qu’ils soient communiqués aux parties afin qu’elles soient en mesure de présenter des observations : les portes étroites ne sont donc pas totalement fermées. Ce faisant, « le Conseil se réserv[ait] la faculté discrétionnaire de tenir compte ou non des observations qui pourraient lui être adressées par des tiers ». Il est vrai qu’accueillir ouvertement les interventions comportait un risque d’encombrement du prétoire du Conseil constitutionnel, puisqu’elles auraient été dépourvues de tout filtrage, contrairement aux QPC elles-mêmes. Toute personne aurait ainsi pu déposer une telle demande, contraignant le Conseil à, au moins, en examiner la recevabilité : il aurait alors pu rapidement être dépassé, sans véritable moyen de faire face à un afflux de demandes.
À l’inverse, ce silence des textes n’était pas sans poser des difficultés quant au respect du contradictoire : les observations déposées devaient-elles être transmises aux parties dans leur intégralité ou le Conseil devait-il seulement indiquer un (éventuel) grief soulevé d’office ? Devaient-elles être systématiquement transmises ou seulement lorsqu’un tel grief pouvait être soulevé ? Le dilemme était réel pour une institution qui dispose d’un effectif restreint et qui est contrainte de statuer dans des délais stricts (trois mois en QPC), rendant difficile le traitement d’un grand nombre de demandes simultanées, alors que, inversement, elle se doit de respecter le droit au procès équitable et ne saurait se fermer (en interdisant les interventions) à l’instant où elle s’ouvre (en accueillant des questions soulevées par des justiciables).
Les demandes en intervention furent donc accueillies, d’abord selon une « bonne pratique » mais de façon plus officielle que les portes étroites du contentieux a priori, puisqu’elles ont été immédiatement mentionnées dans les visas des décisions. Puis, très rapidement, les avocats purent présenter des observations orales à l’audience. Les interventions se multiplièrent et, au moment même où le Conseil constitutionnel se modernisait et se démocratisait, un silence des textes quant aux règles de leur dépôt et recevabilité, susceptible de nuire aux droits de la défense, n’était plus acceptable. Qui pouvait introduire une intervention ? À quel moment ? Pouvait-il se voir communiquer les écritures des parties ? Les observations du Gouvernement ? Autant d’interrogations qu’il était impératif de trancher de façon transparente : tel fut l’objet de la décision du 21 juin 2011, qui modifia le règlement de procédure. Qu’elle intervienne peu après l’introduction de quatre QPC qui générèrent chacune entre vingt-cinq et trente demandes d’intervention n’est sans doute pas un hasard.
Pour la même raison, le Conseil demeurait lui-même une instance fermée, seulement accessible à quelques privilégiés, à l’exception du contentieux électoral. En 2008, il s’ouvrit et se transforma de facto en juridiction, faute d’en avoir le titre de jure, même si tentative avait été faite de le qualifier de « Cour constitutionnelle » lors de la révision constitutionnelle, la consécration intervenant néanmoins de façon indirecte et tardive. Il dut ainsi intégrer toutes les exigences afférentes à une telle évolution, même si plusieurs d’entre elles avaient été anticipées (publication des saisines, publications des observations du Gouvernement, transmission de ces dernières aux requérants et possibilité pour eux de répliquer) et, en particulier, celles relatives au droit au procès équitable et au respect du principe du contradictoire.
Le « Règlement intérieur sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité » du 4 février 2010 tâcha alors de tout prévoir. Ou presque... car il manquait une réglementation des demandes en intervention. Ce silence initial résultait de la volonté de préserver le Conseil, en évitant de les inciter, et du parallélisme vis- à-vis de la procédure a priori, où les interventions existent, mais de façon officieuse. Appelées «portes étroites», selon le mot du Doyen Vedel, elles n’ont aucune valeur officielle, elles ne sont pas mentionnées dans les décisions et sont laissées à la disposition du rapporteur, qui peut décider de s’en servir ou non, de les évoquer en séance ou non, de les suivre ou non, de les jeter ou non, de les encadrer ou non...
Ces portes étroites avaient essentiellement pour objectif d’encourager le Conseil à soulever « d’office » un grief qui n’était pas mentionné par les requérants « officiels ». Lors de l’adoption du règlement de procédure du 4 février 2010, elles furent donc intégrées à demi- mot, puisque l’article 7 réserve la possibilité, pour le Conseil, de soulever des griefs d’office, en imposant alors qu’ils soient communiqués aux parties afin qu’elles soient en mesure de présenter des observations : les portes étroites ne sont donc pas totalement fermées. Ce faisant, « le Conseil se réserv[ait] la faculté discrétionnaire de tenir compte ou non des observations qui pourraient lui être adressées par des tiers ». Il est vrai qu’accueillir ouvertement les interventions comportait un risque d’encombrement du prétoire du Conseil constitutionnel, puisqu’elles auraient été dépourvues de tout filtrage, contrairement aux QPC elles-mêmes. Toute personne aurait ainsi pu déposer une telle demande, contraignant le Conseil à, au moins, en examiner la recevabilité : il aurait alors pu rapidement être dépassé, sans véritable moyen de faire face à un afflux de demandes.
À l’inverse, ce silence des textes n’était pas sans poser des difficultés quant au respect du contradictoire : les observations déposées devaient-elles être transmises aux parties dans leur intégralité ou le Conseil devait-il seulement indiquer un (éventuel) grief soulevé d’office ? Devaient-elles être systématiquement transmises ou seulement lorsqu’un tel grief pouvait être soulevé ? Le dilemme était réel pour une institution qui dispose d’un effectif restreint et qui est contrainte de statuer dans des délais stricts (trois mois en QPC), rendant difficile le traitement d’un grand nombre de demandes simultanées, alors que, inversement, elle se doit de respecter le droit au procès équitable et ne saurait se fermer (en interdisant les interventions) à l’instant où elle s’ouvre (en accueillant des questions soulevées par des justiciables).
Les demandes en intervention furent donc accueillies, d’abord selon une « bonne pratique » mais de façon plus officielle que les portes étroites du contentieux a priori, puisqu’elles ont été immédiatement mentionnées dans les visas des décisions. Puis, très rapidement, les avocats purent présenter des observations orales à l’audience. Les interventions se multiplièrent et, au moment même où le Conseil constitutionnel se modernisait et se démocratisait, un silence des textes quant aux règles de leur dépôt et recevabilité, susceptible de nuire aux droits de la défense, n’était plus acceptable. Qui pouvait introduire une intervention ? À quel moment ? Pouvait-il se voir communiquer les écritures des parties ? Les observations du Gouvernement ? Autant d’interrogations qu’il était impératif de trancher de façon transparente : tel fut l’objet de la décision du 21 juin 2011, qui modifia le règlement de procédure. Qu’elle intervienne peu après l’introduction de quatre QPC qui générèrent chacune entre vingt-cinq et trente demandes d’intervention n’est sans doute pas un hasard.
Désormais, seules les parties justifiant d’un « intérêt spécial » peuvent présenter des observations en intervention, sous un délai qui était de trois semaines lors de la modification du règlement de procédure en 2011 et qui correspond désormais à celui que fixe le Conseil à l’égard des parties pour présenter elles-mêmes leurs premières observations.
Au total, les interventions sont nombreuses, sur des sujets parfois polémiques. Alors que leur non-admission, lorsqu’elle est décidée, est peu motivée, rendant ainsi la notion d’intérêt spécial très ambiguë, elles émanent d’auteurs diversifiés, dans des matières qui ne créent guère de surprises. En définitive, elles bénéficient d’un succès éclatant, à l’éclat toutefois relatif.